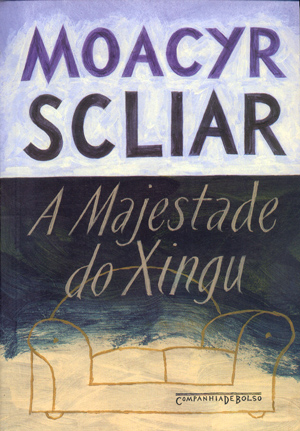Source : Folha de São Paulo, 26/10/1999
Traduction pour Autres Brésils : Pascale Vigier (Relecture : Raphaëlle Loehr)
L’auteur de cette critique littéraire, Cristovão Tezza est un auteur contemporain dont l’ouvrage Le Fils du printemps est traduit chez Métailié. Professeur de linguistique à l’Université fédérale du Parana, il écrit aussi une chronique régulière dans la Folha de São Paulo et la Gazeta do Povo de Curitiba. Il était invité au Salon du Livre à Paris cette année.
— -
Un homme dans une unité de traitement intensif raconte au médecin l’histoire de sa vie : c’est la trame de l’histoire de A Majestade do Xingu, le nouveau livre de l’écrivain gaucho (habitant du Rio Grande do Sul), Moacyr Scliar [1]. Cela paraît simple et banal – et, en effet, c’est une histoire simple et banale, mais de cette manière si particulière dans sa simplicité et sa banalité qui fait souvent la grandeur de la littérature. D’abord, l’homme est un juif russe sans nom dont le seul fait notable, d’après ce qu’il nous dit avec une insistance pathétique, soulignant à chaque ligne sa nullité totale, est d’être venu d’Europe au Brésil, en 1921, sur le cargo Madeira, encore enfant, avec Noël Nutels, ce même Noël qui deviendra des années plus tard le célèbre médecin sanitaire dévoué à la cause des populations indigènes.
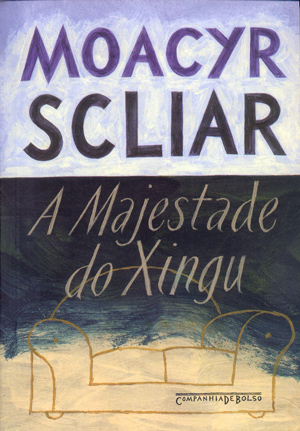
Au Brésil, les familles se séparent pour toujours. Mais notre personnage n’oubliera jamais Noël Nutels, dont nous connaissons quelques épisodes biographiques. En vérité le fameux médecin sanitaire n’a pas d’importance en soi dans le livre ; il est une référence métaphysique, la réalisation d’une idée – altruiste, talentueux, important, admiré, courageux, un homme supérieur, et par-dessus tout un juif ; enfin, un homme qui, étant ce qu’il est, meurtrit le narrateur, lui désigne son insignifiance, lui démontre sa nullité, sa vacuité, sa couardise, sa peur (« Noël était bon, si bon que c’était un saint, un saint juif, un Jéhovah miséricordieux. Moi j’étais mauvais. Mauvais et envieux. Un puits de méchanceté, un puits d’envie. ») Le narrateur n’est rien, jamais il ne peut vouloir n’être rien [2], reprenant le fameux vers de Fernando Pessoa ; mais c’est comme s’il se réfugiait dans cette « contre-identité » ; c’est comme s’il ne pouvait être qu’une chose, en n’étant pas ce que l’autre est. Il y a une affirmation troublante du « non-être » - et peut-être est-ce là son plus grand secret.
Cette relation tendue et folle qui définit l’âme du personnage tout au long d’une narration vertigineuse, s’exprime dans une langue d’une simplicité irrésistible. À partir de la situation initiale, l’homme qui parle à un médecin qui n’intervient pas mais dont la présence représente une autre tension qui ponctue le livre, Moacyr Scliar simule par sa technique une oralité parfaite. C’est l’unique registre de langage capable de dépouiller plus encore le personnage, en lui enlevant toute trace rhétorique, tout projet de pose littéraire, toute ombre de « style ». Ce qui sera aussi une autre révélation : dans ce livre de Moacyr Scliar, la simplicité se trouve moins dans un style que dans la réalisation d’une éthique, d’une éthique possible, autrement dit la grande ombre qui semble tourmenter le narrateur tout au long de sa vie. Une vie qui court, à travers l’oralité, comme le paysage qui défile par la fenêtre d’un train rapide – début et fin qui se complètent en une structure narrative d’une unité rare.
Une vie insignifiante – l’arrivée au Brésil, la mort du père qui vendait des cravates avec le moignon du bras qu’il avait perdu, un père nostalgique du comte Alexei, dont il réparait les bottes, ensuite le travail dans une boutique dont il devient propriétaire, puis un mariage insipide, un fils, deux ou trois connaissances, enfin la solitude de toujours et l’Unité de soins intensifs – Et, pourtant, pour le lecteur, quelle vie trépidante ! Derrière le comptoir de sa nullité, notre héros imagine des divagations d’allégresse qui se déploient en châteaux délirants d’une autre vie, ponctuée autant d’hôtesses de l’air qui l’aiment dans des bulles de plastique en plein ciel, que d’une nouvelle rencontre chaleureuse avec un Noël Nutels qui, dans ses rêves, le reconnaîtrait immédiatement même des années après. Et l’homme qui raconte encourage aussi le rêve de la communion universelle, mentale et géographique, le sublime avec l’immonde, la convergence de l’indien avec la civilisation, le Xingu considéré comme le nombril du monde, où il placerait sa boutique « La Majesté », réalisant à sa manière l’idéologie de son idole Noël. Une trajectoire purement mentale avec des pointes hilarantes, comme celle du major Azevedo, militaire de la répression, contraint au silence à cause d’une inscription dans les toilettes à propos de sa femme, ou celle de la militante Sarita, en ville, vociférant avec les indiens contre l’impérialisme de l’homme blanc, en accord avec l’orientation idéologique de sa cellule stalinienne.
Si d’un côté le livre est très brésilien par ses références immédiates, de l’autre il s’inscrit, selon les propres mots du narrateur, dans le « flux ininterrompu du torrent spirituel qui emporte, comme des troncs ou des rameaux, tous les écrivains, tous les lecteurs, tous ceux qui se précipitent tête la première dans le courant abondant du texte ». Dans un affluent important de ce grand courant nous rencontrerons la famille littéraire de Scliar, à présent dans l’un de ses moments les plus inspirés : « la faute juive immémoriale, la faute qui nous accompagnait de pays en pays, de région en région, dans notre pérégrination millénaire ». Dans son roman, Scliar développe avec subtilité aussi bien le thème du « double » (que l’écrivain américain Philip Roth a porté à son extrême dans Operation Shylock), que celui de la « faute immémoriale » ; dans ce domaine, le personnage torturé de Scliar ira de pair avec les héros d’un autre romancier américain, Bernard Malamud (Le Commis [3]), une compagnie à la hauteur.
En un mot : La Majesté du Xingu est un beau roman.
Notes du traducteur :
[1] Moacyr Scliar, écrivain brésilien contemporain (1937-2011), est fils de parents originaires de Bessarabie émigrés au Brésil en 1904. Médecin de formation, il s’est illustré dans de nombreux genres littéraires dont les thèmes dominants sont la réalité sociale de la classe moyenne brésilienne dans les villes, la médecine et le judaïsme.
[2] « Não sou nada. Nunca serei nada, não posso querer ser nada. », premiers vers de Tabacaria, poème signé d’un des hétéronymes de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos.
[3] The Assistant, 1ère trad. Française Gallimard, 1960.