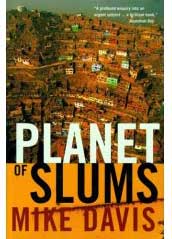<img506|center>
FSP - Votre dernier livre décrit un processus apparemment irréversible de favelisation des pays les plus pauvres. Est-ce à dire que nous atteignons un point de non-retour pour résoudre la question du logement ?
<img507|left> Mike Davis - Il est bien clair, selon les spécialistes de l’habitat dans presque tous les pays pauvres, que nous arrivons à la fin de la frontière des espaces libres, ou presque, pour l’occupation de terrains. C’est un fait de notre temps, surtout parce qu’autant gouvernements et institutions internationales continuent à penser que le pauvre a accès à la terre et peut résoudre la crise du logement par détermination propre et selon son propre génie. Mais le temps de l’invasion héroïque est passé. L’occupation traditionnelle stricto sensu est maintenant seulement possible dans des lieux résiduels et dangereux, où inondations, imperfections du terrain ou proximité de dépôts toxiques font que le terrain est presque sans valeur, et que la vie est une lutte constante contre le désastre. Dans les tous les autres espaces, la terre périphérique est une marchandise - de propriété légale ou illégale des spéculateurs, des hommes politiques ou d’entités tribales qui vendent la terre aux résidents pauvres. Les recherches montrent une convergence dangereuse de coûts de logement croissants (la fin de la frontière et de la terre occupable) avec la sursaturation des secteurs économiques informels Cette « urbanisation pirate », selon l’expression consacrée, résulte effectivement de la privatisation des occupations. Des personnes très pauvres, qu’elles soient des filles de la ville ou des migrants de l’intérieur, louent actuellement leur petite baraque (généralement auprès d’habitants de bidonvilles plus anciens et légèrement plus riches) ou sont forcés à construire dans des lieux précaires ou dans les régions limitrophes, où les coûts de transport annulent l’avantage de la terre d’accès libre ou bon marché. Dans l’habitat, ainsi que dans l’économie informelle, on observe ce qui peut être appelé de « marginalisation à l’intérieur de la marginalité ».
FSP - Vous affirmez que, dans quelques villes, l’utilisation du terme périphérie est devenue inexacte, puisque les bidonvilles sont devenus le centre de la vie urbaine. Qu’est-ce qui arrive quand une ville atteint ce point ?
Davis - Personne ne sait. La périphérie, évidemment, prend différentes formes. Dans quelques cas, les pauvres suivent les emplois, ce qui est la meilleure option, je suppose. Dans d’autres cas, ils sont simplement exilés par le coût élevé des terrains ou expulsés par la rénovation des bidonvilles. Le déplacement d’un extrême vers le centre absorbe une quantité croissante de temps et d’argent, à un niveau presque insoutenable. A Nairobi et dans d’autres villes africaines et asiatiques, les pauvres dépensent plus dans le transport que dans le logement, les médicaments ou dans l’éducation des enfants. C’est le grand problème de la forme urbaine : il s’agit d’une urbanisation qui ne réussit pas à créer un urbanisme, qui pousse simplement les personnes vers un dehors toujours plus éloigné (en consommant de précieuses terres cultivables et des réserves environnementales) et ne fournit aucun appareil d’intégration à la ville traditionnelle. Toutes les contradictions de la suburbanisation des pays riches deviennent exponentiellement plus fortes dans les villes pauvres.
FSP - Récemment, l’Armée est intervenue dans des bidonvilles de Rio, avec l’appui d’une partie de la classe moyenne. La sécurité publique devrait être la grande priorité ?
Davis - En premier lieu, « sécurité publique » est une expression trompeuse. Des opérations militaires et des prisons en masse ne font qu’aggraver l’insécurité urbaine à long terme. À moins qu’on ne soit disposé à exterminer des contingents entiers de personnes, la criminalisation de l’inégalité ne fait que stocker le problème dans des prisons inhumaines, d’où il sera finalement exporté de retour vers la rue à un degré plus violent. En outre, le crime de rue est toujours pire là où la police est plus corrompue et sans règles. Les mauvais policiers sont le plus grand problème criminel du monde. Selon ce que je comprends du Brésil, la racine la plus profonde de l’"insécurité" - outre les niveaux fantastiques d’inégalité socioéconomique -, c’est que les pauvres voient toujours la police comme incorrigiblement corrompue, prédatrice au lieu d’être protectrice. La dictature avait déclaré la guerre aux favelas qu’on voyait comme des serres de la subversion ; la dictature a été remplacée par la démocratie bourgeoise, mais la guerre dans les bidonvilles a continué de façon incessante, et les militaires ont gardé beaucoup de liberté pour opérer sans considération des droits de l’Homme. Il est clair que le Brésil et l’Afrique du Sud, suivis par les USA, conduisent la tentative mondiale de substituer la sécurité physico-architecturale pour la classe moyenne par la justice sociale aux pauvres. Évidemment, c’est un cercle vicieux : plus les classes moyennes se retirent de l’espace urbain public et citoyen - ou plus elles permettent que la police et les gardes privés agissent à l’écart de la loi - plus les pauvres croient que la ville est en état de guerre, où les bandes sont aussi légitimes que le gouvernement ou l’État.
FSP - Comment expliquez-vous le paradoxe, présenté dans votre livre, de la croissance des villes du Tiers Monde malgré leur déclin économique ?
Davis - Personne ne peut expliquer totalement ce paradoxe, mais la réponse simple est la subdivision de la pauvreté - ce que j’appelle « involution urbaine ». Au fur et à mesure que les personnes s’entassent dans des niches de survie informelle - travailleurs ambulants, journaliers, de la prostitution, des services domestiques, petits criminels, etc. - plus la masse devient pauvre. Je sais que [l’économiste péruvien Hernando] de Soto et autres populistes néo-libéraux croient que la micro-entreprise peut faire des miracles, mais cela n’est vrai que dans des cas isolés. Il sera toujours possible de trouver des mendiants devenus millionnaires, mais il ne faut pas négliger le nombre infiniment supérieur de personnes qui, hier, étaient ouvriers et employés publics et qui, aujourd’hui, sont des mendiants. A l’échelle macro, on ne saurait établir que l’économie informelle est un moteur de croissance ou un avenir viable pour les pauvres de la ville. Mon livre fait valoir, par contre, que les recherches montrent une convergence dangereuse des coûts croissants du logement (la fin de la frontière et de la terre occupable) avec la sursaturation de secteurs économiques informels (le problème de l’"involution"). Qu’arrive-t-il alors ? Le pire exemple est celui de Kinshasa (Congo, ex-Zaire), une ville de grand esprit, mais dans des conditions indescriptibles de négligence, où les enfants sont laissés dans la rue parce que les familles ne peuvent plus avoir un niveau minimal de survie.
FSP - Vous citez un programme de l’administration du PT à São Paulo pour montrer l’échec de la politique soutenue par la Banque mondiale (Bird) en vue d’améliorer les favelas. Pourquoi ce chemin n’est-il pas viable ?
Davis - Les recommandations contemporaines en matière d’habitat et de développement économique adorent une stratégie « de parfumerie ». En laissant de côté les nombreux exemples où des « favelas-modèle » financées par la Bird sont devenues tout sauf un modèle, les succès de cette stratégie sont presque insignifiants à l’échelle macro : à ce rythme, cela prendrait des siècles pour atteindre la justice face au logement et au pouvoir. Dans le meilleur des cas, la Bird et les gouvernements réformistes fournissent seulement les ressources suffisantes pour promouvoir la mobilité économique d’une petite fraction de la classe travailleuse : récompenser des membres du parti, coopter de possibles activistes et gagner la prochaine élection (ou donner à des ONG collaboratrices des lettres de créance à restituer à leurs donneurs). C’est un monde de petites usines à philanthropie et d’aide mutuelle, qui font difficilement progresser la société.
FSP -. Malgré le vaste spectre idéologique des gouvernements du Tiers Monde, il semble que vous n’ayez pas trouvé de politique de logement efficace. C’est un signe de faillite partagée entre la gauche et la droite, ou la faute revient surtout au capitalisme globalisé ?
Davis - Je suis bien embarrassé pour répondre. La solution - dans l’abstrait tout au moins - doit être un système qui préserve tous les éléments créatifs de l’autoconstrution avec une augmentation radicale de l’investissement social (sous forme d’achat de matériaux, de services d’ingénierie et de développement d’infrastructures). Il n’y a nulle part aucune manière pratique de résoudre la crise urbaine sans une véritable imposition progressive, sans contrôle de l’inégalité et de la consommation ostentatoire et sans maîtrise draconienne de la spéculation immobilière. Cela s’est produit à Cuba au début (ensuite dévié par la croissante dépendance des modèles soviétiques et par l’embargo américain) et se produit aujourd’hui à Caracas, d’une certaine manière. Je peux me tromper, mais je ne crois pas que le PT se soit jamais prononcé en faveur de la volonté de faire une réforme fiscale radicale ou de limiter les privilèges des riches.
FSP - Vous montrez que la « manhattanisation » (verticalisation) des premières favelas de Rio de Janeiro procède d’une tendance mondiale au manque d’espaces dans les métropoles. Quels problèmes - sociaux et écologiques - cela cause-t-il ?
Davis - La densification est positive parce qu’environnementalement efficace. Elle est mauvaise quand elle s’accompagne de l’éparpillement et de la destruction de l’espace vert et des poumons de la ville. Rio et Istanbul sont des exemples fascinants où des favelas d’en bas et la « gecekondus » sont devenus des archipels de mini-Manhattans. C’est un défi pour le planificateur et l’architecte : la favela qu’on voudrait faire monter vers le ciel. Les problèmes sont immenses, mais les opportunités aussi. Toutes les villes ont besoin d’un laboratoire de l’avenir - un quartier où des enfants, des poètes et des utopistes puissent jouer avec l’avenir. Rio pourrait congeler les loyers et les valeurs de la propriété dans la favela, enlever la police et inviter les citoyens à poursuivre leurs rêves. Un bidonville converti en étude de cas, où les architectes et les urbanistes entrent et sortent, mais laissent le pouvoir de décision entre les mains des habitants. Avec le temps, les personnes vont développer des solutions et des projets fantastiques, que les autres pourront répéter ou améliorer. Peut-être même les riches seraient alors tentés de sortir de leurs complexes résidentiels fortifiés.
FSP - Selon vous, le racisme a eu un rôle important pour définir qui habite où. Quelle est l’importance de la discrimination raciale dans la « favelisation » ?
Davis - La race, toujours. Mais les bidonvilles, précisément à cause de leur énergie inter-raciale et interculturelle, sont les dynamos de notre culture planétaire. À Los Angeles, les industries de la musique et de la mode maintiennent des espions dans les ghettos et les « quartiers » pour identifier les tendances qui vont éventuellement s’éparpiller parmi les faubourgs et les classes moyennes. En outre, la sensibilité de la diaspora noire structure le sentiment envers la jeunesse pauvre urbaine (et de nombreux riches) dans des villes de presque partout. Les favelas et les taudis sont incroyablement locaux et paroissiaux, mais ils sont aussi universels.
Source : Folha de São Paulo - 26 mars 2006
Traduction : Etienne Henry pour Autres Brésils