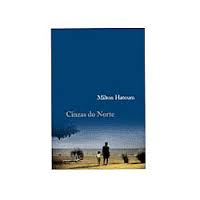Source : Passei Web
Traduction partielle pour Autres Brésils : Regina M.A. Machado (Relecture : Pascale Vigier)
Avec le roman Cinzas do Norte, Milton Hatoum a atteint son objectif d’écrire « l’histoire morale de sa génération ».
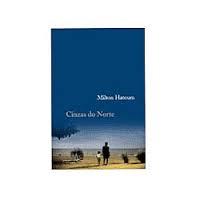
Cinzas do Norte, le roman le plus ouvertement politique de Hatoum, débute sur le même registre désenchanté qui clôt Dois irmãos. C’est un roman dont le langage sec et objectif raconte l’une des histoires possibles d’une génération qui a rêvé d’un monde plus juste, mais qui, dans sa maturité, n’en retrouvera que les cendres. […]. Le titre, emblématique, va programmer la narration.
Le « Nord » du titre n’indique pas une direction possible, un guide pour s’orienter dans des chemins incertains. Il représente la fin, les cendres d’un projet personnel interrompu, comme c’est le cas de l’artiste Raimundo. Le titre est une métaphore de beaucoup de choses, des personnages qui finissent en cendres, de la ville, détruite et reconstruite à plusieurs reprises, tout comme tant de villes latino-américaines. Métaphore aussi de ce Nord d’un parcours qui est la définition classique du roman, une trajectoire de vie qui finit en cendres, absorbée par les adversités, par les égarements, par le destin lui aussi devenu cendre.
L’écrivain part de bases réelles pour élaborer sa fiction. Les protagonistes sont contemporains d’Hatoum, nés au début des années 50. Le long de la trame, ils accompagnent ce que lui-même a vécu : le coup d’état de 1964, les Années de Plomb, le « miracle économique » et l’ouverture politique. L’auteur a été élève au collège Pedro II de Manaus, par où passent Lavo et Mundo.
La dictature militaire ne joue pas un rôle central dans le roman, il n’y a ni digressions humanitaires ou politiques, ni un panorama artistique et culturel de la période. Ces éléments, qui font partie du décor, sont présents et ils ont une fonction, mais le fondamental se trouve plutôt dans ce qui n’est pas dit directement : il y a dans Cinzas do Norte une atmosphère qui entoure les personnages, mais qui ne peut être appréhendée que dans la narration, à mesure que l’on avance dans la lecture.
La narration se déroule dans la capitale amazonienne, Manaus, la ville natale de Hatoum. C’est une trame angoissée et amère. L’histoire oppose deux familles, l’une riche et l’autre pauvre, et les points de vue se multiplient à mesure que l’histoire fait appel à des retours en arrière.
[…] Il capte l’atmosphère et la topographie de sa région, mais ce n’est pas un régionaliste ; en même temps il crée une galerie de personnages dotés de profondeur psychologique, sans faire de littérature urbaine. Le tableau ainsi dressé va de l’environnement au vide de l’âme, amalgamant le social et l’existentiel.
[…] Comme nous l’avons vu, Cinzas do Norte livre une histoire qui se passe dans les années qui vont du Coup d’Etat de 1964 jusqu’à l’ouverture démocratique des années 1980. Dans cet intervalle, l’on suit notamment les trajectoires parallèles de deux amis, Lavo (le narrateur) et Mundo (le protagoniste), de l’enfance à l’âge adulte.
Mundo, ou Raimundo, rêve d’être un artiste. Il est passionné de dessin depuis tout petit et il ignore toute éducation formelle. Né dans une famille riche et décadente, il vit en un conflit permanent avec son père, le millionnaire Jano, un ami des militaires, qui n’accepte pas que son fils échange les affaires familiales contre l’art. Il fait tout pour écraser son rêve, car il méprise la rébellion et les talents artistiques du jeune homme, auquel il dispute l’amour de sa femme, Alicia, la mère du garçon, laquelle encourage son talent. Le long des pages, surgissent des intrigues et des rapports mal résolus entre les deux clans, le tout étant dévoilé avec subtilité, ou même à peine suggéré. D’autres narrateurs se joignent à Lavo, et les différentes versions de l’histoire finissent par former un cercle qui ne se fermera que dans les dernières lignes.
Lavo, qui raconte tout à la première personne, est un orphelin ; il a perdu ses parents dans un naufrage et a été élevé par ses oncles Ramira et Ranulfo, frère et sœur de feue sa mère. Ramira était couturière et éprise de Jano, tandis que Ranulfo était un ex-amoureux, ex-beau-frère et éternel amant d’Alicia, la mère de Mundo, qui l’a abandonné pour l’argent et le standing de Jano.
Lavo est un narrateur observateur : bien que tous les faits contés soient directement liés à sa vie, il raconte d’un point de vue extérieur. Il devient à la fin un avocat des détenus oubliés dans les prisons.
Ranulfo est un bohémien errant typique et, comme sa mère, il pousse Mundo à prendre au sérieux ses désirs artistiques.
Dans cette histoire, Lavo présente et raconte la vie de son oncle Ran, Ranulfo, un artiste égaré dans les terres, dans les rues qui se traçaient dans la grande Manaus ; un connaisseur des eaux, des rivières où vient se dissoudre l’immense Amazonie, des fleuves qui serpentent, qui ondulent devant les yeux des caboclos qui, à force de les regarder, ne font que se laisser entraîner par la rêverie des eaux, des paranas, des trous. L’oncle Ran qui, à la fin de sa vie, fatigué de tout perdre sauf sa liberté, se balançant dans le hamac prêté par un ami, lisait des romans. Ramira, sa sœur, toujours gênée par la vie bizarre que menait son frère, que Lavo enfant entendait dire : « Je travaille, ma sœur. » Plus tard, Lavo comprendrait que c’était là une des définitions de la littérature.
Quant à Ranulfo, son amour pour Alicia a été la grande cause de sa vie. Alicia, la mère de Mundo, une parfaite « cabocla » amazonienne, incomparable dans sa beauté et dans ses conflits, illustre les intersections de la richesse et de la misère, les conflits d’ascendance et chambardement des races, des cultures et du sang ; incompatibilités nécessaires et recherche de l’unicité humaine dans l’autre. Tout cela se confond en elle. Elle qui n’a jamais su qui était son père, peut-être un Français qui n’a laissé qu’un seul vestige dans Cinzas do Norte. La femme pauvre qui un jour a débarqué sur les rives du fleuve Negro, accompagnée de sa sœur Algisa et d’une Indienne qui n’abandonnait pas ses coutumes exotiques, s’est mariée avec un descendant de Portugais. Celui-ci, homme riche et mesquin, propriétaire de la Vila Amazonia, proche de Parintins […] et qui était censé être le père de Mundo, le fils qui n’a jamais été son fils, parce qu’il était le fils de Aranda, faux artiste de la ville de Manaus qui s’ouvrait alors au monde, et parce que Jano voulait un héritier pour son immense fortune et non pas un fils. La naissance de cet enfant a marqué l’éloignement entre Alicia et Jano, abréviation de Trajano.
Hatoum établit ainsi peu à peu le doute sur la paternité de Mundo. Des lettres de l’oncle Ran à Mundo emplissent le livre, intercalées entre les chapitres.
Mundo et Lavo représentent les deux chemins opposés qui ont marqué la jeunesse de cette génération : ou bien être artiste et/ou engagé et lutter pour les changements sociaux, ou bien se conformer et porter son costume-cravate en attendant tranquillement son salaire à la fin du mois. Comme dit Mundo, « l’obéissance stupide ou la révolte », sans s’apercevoir, dans son radicalisme naïf, combien ces deux chemins, malgré toutes leurs différences, se terminent pareils (« dans ce monde, plus on vit, plus on voit le pire », dit le chauffeur de Jano). Ils finissent dans une implacable désillusion.
L’amitié de Lavo et Mundo n’est pas évidente. Plus que de l’affection, ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre est une sorte de nécessité mutuelle, une envie envers l’autre. Lavo envie le courage, l’audace, le talent et le non-conformisme de Mundo. Et celui-ci envie une supposée liberté à son ami qui n’a pas de père ni personne qui l’empêche de réaliser ses rêves, ne serait-ce que parce que Lavo n’a pas de rêves. Il manque de ténacité. Il devient avocat par manque de volonté de se décider à faire autre chose.
La dissolution familiale est toujours un thème fort pour l’auteur, et la haine entre père et fils, encore plus frappant. La littérature de Hatoum se nourrit de conflits. Le conflit culturel, entre l’occidental et l’oriental qui se fondent mais qui maintiennent son œuvre toujours universelle, jamais régionaliste. Le conflit entre la tradition familiale, générationnelle, et la modernité industrielle qui étouffe, opprime, pervertit Manaus, chasse les habitants du bord du fleuve. Le conflit entre la nature des fleuves et « igarapés », la forêt amazonienne et la concrétude urbaine, les places déchirées par des avenues. Le conflit entre le langage cultivé, élégant, et le langage familier, hérité de l’oralité et présent dans les dialogues à la deuxième personne. L’adjectif le plus adéquat à la prose de Hatoum : hypnotique.
Cinzas do Norte instaure encore une discussion intéressante sur la fonction de l’art. Engagée ou commerciale ? Expérimentale ou conventionnelle ? Mundo […] voit une fonction sociale dans son art, une discussion qui remonte à Sartre et à Glauber Rocha, tandis qu’Arana, son gourou, [... ]qui a envie d’apparaître comme un artiste, accepte des travaux sur commande et s’exhibe devant des touristes. En fin de comptes, il devient un exportateur d’objets fabriqués en bois précieux, valorisés à l’étranger, et il gagne beaucoup d’argent. Quant à la littérature, Lavo apprend avec son oncle qu’écrire, c’est travailler avec l’imagination des autres et avec la sienne propre.
Le désir d’appartenir à un lieu et la sensation permanente de déplacement, où que l’on soit, sont autant de dilemmes communs aux personnages. Manaus, avec sa chaleur oppressante et ses limites circonscrites par les bras des fleuves, représente une sorte de confinement pour les protagonistes de Cinzas do Norte. Cependant, en sortir ne conduit pas à la liberté. Mundo flâne à Rio de Janeiro, à Berlin, à Londres, uniquement pour se percevoir prisonnier du passé représenté par sa ville d’origine. « Ma réclusion n’est pas un attribut de la géographie », conclut-il dans une lettre à Lavo.
C’est ainsi que, dans les trajectoires de Lavo et Mundo nous retrouvons avec surprise et familiarité mélangées, l’histoire de vies restées sur le chemin, les amours interrompues par la peur, les espoirs perdus dans le temps. C’est là que l’écrivain et le lecteur, réunis dans le pacte silencieux de la parole qui pointe vers un monde où rien ne leur est étranger, recueillent, chacun à sa manière, les restes calcinés d’un lieu pas si distant.